Depuis une dizaine d’années, un intérêt marqué pour la nature sauvage s’est fait jour. Pour preuve, toute une série d’ouvrages parus en France et à l’étranger.
par Jean-Claude Génot
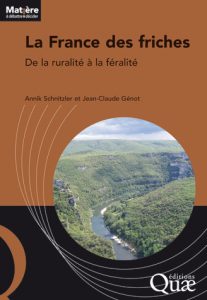 La France des friches. De la ruralité à la féralité, livre que j’ai écrit avec Annik Schnitzler (JNE), paraît en 2012. Cet ouvrage à caractère scientifique fait le point sur l’historique des friches, leur perception sociale et les phénomènes de succession végétale en fonction des aires biogéographiques (montagnard, atlantique, méditerranéen, tropical pour les régions d’outre-mer) et des situations écologiques (milieux terrestre et alluvial). Les auteurs ont introduit la notion de féralité, pour qualifier des espaces agricoles ou forestiers exploités par l’homme puis laissés en libre évolution. Ce livre est un plaidoyer pour les friches qui, laissées à elles-mêmes, sont capables de reconstituer naturellement des écosystèmes forestiers riches et diversifiés si on leur laisse du temps et de l’espace.
La France des friches. De la ruralité à la féralité, livre que j’ai écrit avec Annik Schnitzler (JNE), paraît en 2012. Cet ouvrage à caractère scientifique fait le point sur l’historique des friches, leur perception sociale et les phénomènes de succession végétale en fonction des aires biogéographiques (montagnard, atlantique, méditerranéen, tropical pour les régions d’outre-mer) et des situations écologiques (milieux terrestre et alluvial). Les auteurs ont introduit la notion de féralité, pour qualifier des espaces agricoles ou forestiers exploités par l’homme puis laissés en libre évolution. Ce livre est un plaidoyer pour les friches qui, laissées à elles-mêmes, sont capables de reconstituer naturellement des écosystèmes forestiers riches et diversifiés si on leur laisse du temps et de l’espace.
En 2013, dans le livre Feral. Searching for Enchantment on the Frontiers of Rewilding, le journaliste et écologue George Monbiot voit dans la nature férale une nature accessible à tous plutôt que d’aller au bout du monde voir les derniers espaces sauvages. Il voit le ré-ensauvagement non pas comme un abandon de la civilisation mais au contraire comme un moyen de l’améliorer. Et quand l’auteur parle de ré-ensauvagement, ce n’est pas seulement pour faciliter le retour du loup, du lynx ou du bison mais aussi celui du lion, de la hyène tachetée ou du rhinocéros noir, présents en Europe il y a 12 000 ans. Une utopie ne tenant pas compte des réalités humaines ? Non car George Monbiot propose de ré-ensauvager les hautes terres d’Ecosse livrées au surpâturage et aux plantations d’arbres exotiques mais qui malheureusement sont composées de vastes domaines privés dont les propriétaires sont peu sensibles à la nature sauvage. Le livre est truffé de données scientifiques référencées sur l’histoire des espèces, l’évolution des paysages depuis les dernières glaciations, la théorie des méga herbivores avec de bons arguments contre ceux qui pensent que ces derniers ont entretenu des milieux ouverts, le rôle de l’homme dans l’extinction de la mégafaune ou encore les effets en cascade dans les chaînes alimentaires quand une espèce clé vient à disparaître. L’auteur souligne, après avoir vu des écosystèmes en fonctionnement naturel dans diverses régions du monde, que moins ces milieux sont modifiés plus ils sont diversifiés et complexes. D’où sa grande incompréhension face aux gestionnaires britanniques qui, selon lui, voient les réserves comme des jardins botaniques, n’aiment pas les arbres et empêchent toute intrusion de la nature.
En 2014, Pierre Athanaze publie Le retour du sauvage dans lequel il évoque les retours naturels (loup, cigogne noire) et les réintroductions (lynx, castor, vautours) d’espèces sauvages ainsi que les effacements de barrages et la restauration naturelle de la forêt dans les zones agricoles en déprise.
Un ouvrage scientifique, Rewilding European Landscapes, sous la conduite de Henrique M. Pereira et Laetitia M. Navarro, paraît en 2015. Cet ouvrage est une synthèse théorique et pratique du ré-ensauvagement ou retour du sauvage (Rewilding) en Europe. Les auteurs définissent le ré-ensauvagement comme une gestion passive de la succession écologique avec pour but de restaurer les processus naturels et de réduire le contrôle de l’homme sur les paysages. L’enjeu est de taille car selon les auteurs d’ici 2030, 20 millions d’hectares de zones agricoles vont être abandonnées en Europe, soit deux fois la taille du Portugal.
Pour ma part en 2017, dans Nature : le réveil du sauvage, après une mise au point sur le concept de sauvage et de wilderness, j’ai passé en revue les nombreuses initiatives qui se font jour à travers l’Europe pour préserver les derniers bastions de nature sauvage, voire pour renforcer le ré-ensauvagement de régions en déprise agricole.
En 2018, dans Ré-ensauvageons la France. Plaidoyer pour une nature sauvage et libre, Gilbert Cochet et Stéphane Durand soulignent les atouts de la France en termes de diversité biologique, malgré tout ce que la nature a enduré au XXe siècle. Ils nous rappellent que de nombreuses espèces devenues rares ont regagné du terrain tandis que d’autres sont revenues naturellement ou ont été réintroduites avec succès. Mais surtout, ils font des propositions de ré-ensauvagement par grands types de milieux (montagnes, forêts, littoraux et rivières) et énoncent des recommandations pour favoriser partout la faune sauvage, prédateurs compris (moins de chasse, plus d’aires protégées, moins d’interventionnisme dans la nature).
 Également en 2018, la philosophe Virginie Maris publie La part sauvage du monde. Penser la nature dans l’Anthropocène. L’auteure souligne l’importance de considérer la nature sauvage comme une altérité à respecter et une autonomie dont l’homme peut s’inspirer. Elle présente un « kit » de défense intellectuelle du sauvage face aux nombreuses critiques qui sont faites à ses défenseurs. Pour l’auteure, la défense de la part sauvage du monde n’est pas une démarche fixiste, elle n’est ni un signe de misanthropie, ni une démarche néocoloniale. En guise de conclusion elle souligne : « il est également urgent de préserver des espaces et des territoires où les êtres de nature peuvent faire sans nous » ; une manière de fixer des limites à la domestication totale de la nature.
Également en 2018, la philosophe Virginie Maris publie La part sauvage du monde. Penser la nature dans l’Anthropocène. L’auteure souligne l’importance de considérer la nature sauvage comme une altérité à respecter et une autonomie dont l’homme peut s’inspirer. Elle présente un « kit » de défense intellectuelle du sauvage face aux nombreuses critiques qui sont faites à ses défenseurs. Pour l’auteure, la défense de la part sauvage du monde n’est pas une démarche fixiste, elle n’est ni un signe de misanthropie, ni une démarche néocoloniale. En guise de conclusion elle souligne : « il est également urgent de préserver des espaces et des territoires où les êtres de nature peuvent faire sans nous » ; une manière de fixer des limites à la domestication totale de la nature.
Enfin, en 2018 un autre ouvrage scientifique collectif, Rewilding, est publié par Nathalie Pettorelli, Sarah M. Durant et Johan T. Du Toit. Il définit ce que recouvre ce terme et fait le point sur les opérations de ce type dans les diverses régions du monde. Aujourd’hui le rewilding comprend le rétablissement des successions végétales, la réactivation des interactions trophiques et des processus de prédation et l’amélioration des services écosystémiques délivrés par la réintroduction d’espèces ingénieurs (castor, herbivore, carnivore). Les publications avec le mot rewilding ont fortement augmenté à partir de 2013, mais ces articles recouvrent aussi des actions déjà mentionnées avant avec d’autres mots clés. On parle même de rewilding du Pléistocène quand on veut restaurer les processus écologiques perdus suite à l’extinction de la mégafaune du Pléistocène. Cela consiste à prendre des espèces proches de celles éteintes, souvent domestiques (bovins, chevaux) mais sans connaître vraiment l’impact de ces introductions. Ce sujet est une des critiques faites à ce genre d’opération car ré-ensauvager en introduisant des animaux domestiques constitue un bel oxymore.
Dans les ouvrages français cités, ce n’est pas un hasard si trois des auteurs, Pierre Athanaze, Gilbert Cochet et moi-même sommes des co-fondateurs de Forêts Sauvages, association créée en 2005 pour acquérir des forêts et les laisser en libre évolution. De plus, Forêts Sauvages publie Naturalité, une lettre numérique avec près de 850 abonnés, qui fait la part belle à la nature sauvage.
Ce mouvement en faveur de la nature sauvage est d’abord une réaction à la gestion interventionniste de la biodiversité faite de culture, d’élevage et de jardinage, pour reprendre les expressions de Robert Hainard, artiste, naturaliste et philosophe suisse. Il répond également à une situation de régression globale de la nature. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Parlement européen a rédigé en 2009 un rapport sur la nécessité de protéger la nature sauvage en Europe.
Toutes les étapes de cet enchaînement et les multiples initiatives qui en découlent prises par des ONG dans toute l’Europe sont détaillées dans mon ouvrage Nature : le réveil du sauvage. Certes, les mots ont un certain pouvoir, mais les livres ne suffisent pas, seuls, à changer les mentalités, surtout en France (voir mon précédent texte sur la spécificité française anti-nature). Tant que les gouvernants maintiennent le cap sur la croissance économique et que les lobbys agro-sylvo-cynégétiques continuent de supprimer le sauvage, tout ce qui se fera en faveur de la nature sauvage ne sera que de la résistance isolée. C’est bien pour raviver le feu du vivant comme le dit le philosophe Baptiste Morizot, mais c’est insuffisant pour instaurer un nouveau pacte entre la société moderne et le sauvage.
Ce d’autant, qu’à peine émergent en France et en Europe, ce souci du sauvage est plus que contesté aux Etats-Unis, pays où pourtant la wilderness est un long héritage historique et qui a toujours une longueur d’avance pour les concepts en matière de biologie de la conservation. Ainsi le premier livre traitant du rewilding est paru en 2004 (Rewilding North America). Il a été rédigé par Dave Foreman, écologiste américain, ardent défenseur du sauvage qui est considéré comme l’initiateur du terme rewilding lié à la wilderness et consistant à relier entre elles les aires de wilderness. Cette reconnexion du sauvage a été appelé les « 3 C » comme cœur, corridor et carnivores. Le cœur étant composé des aires de wilderness, les corridors reliant ces dernières et les carnivores étant considérés comme les espèces phares sur le plan de diversité, mais surtout de la fonctionnalité des écosystèmes au travers des chaînes alimentaires qu’il faut réintroduire.
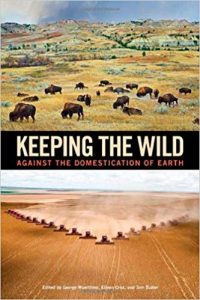 Il y a eu un grand débat sur la wilderness dans les années 1990 dont j’explicite les tenants et aboutissants dans mon ouvrage sur le sauvage. Mais en 2011, un article de Peter Kareiva, responsable du département scientifique de l’ONG Nature Conservancy, l’une des plus grandes organisations environnementales au monde, a relancé les débats dans le monde de la conservation américain qui ont fait l’objet d’un ouvrage Keeping the wild. Against the domestication of earth dont les éléments suivants sont extraits (1). Qualifié de « néo-environnementaliste », ce conservationniste développe les idées suivantes. La nature est plus résiliente que fragile. Les humains dégradent et détruisent leur environnement naturel et 80 % du temps, il se rétablit très bien. La nature sauvage n’existe pas, tout a été influencé par les humains. Essayer de protéger des écosystèmes fonctionnels du développement humain est futile. Les humains aiment le développement et on ne peut pas les en empêcher. La nature est résistante et s’adapte à cela. Aujourd’hui, les coyotes se déplacent dans Chicago et les faucons pèlerins étonnent les habitants de San Francisco quand ils volent entre les gratte-ciel. Nous détruisons des habitats, nous en créons de nouveaux. Maintenant que la science a montré que rien n’est vierge et que la nature s’adapte, il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour les objectifs environnementaux traditionnels comme la protection des forêts tropicales. Kareiva et ses collègues se demandent si l’arrêt de la déforestation de l’Amazonie est faisable. Est-ce même nécessaire ?
Il y a eu un grand débat sur la wilderness dans les années 1990 dont j’explicite les tenants et aboutissants dans mon ouvrage sur le sauvage. Mais en 2011, un article de Peter Kareiva, responsable du département scientifique de l’ONG Nature Conservancy, l’une des plus grandes organisations environnementales au monde, a relancé les débats dans le monde de la conservation américain qui ont fait l’objet d’un ouvrage Keeping the wild. Against the domestication of earth dont les éléments suivants sont extraits (1). Qualifié de « néo-environnementaliste », ce conservationniste développe les idées suivantes. La nature est plus résiliente que fragile. Les humains dégradent et détruisent leur environnement naturel et 80 % du temps, il se rétablit très bien. La nature sauvage n’existe pas, tout a été influencé par les humains. Essayer de protéger des écosystèmes fonctionnels du développement humain est futile. Les humains aiment le développement et on ne peut pas les en empêcher. La nature est résistante et s’adapte à cela. Aujourd’hui, les coyotes se déplacent dans Chicago et les faucons pèlerins étonnent les habitants de San Francisco quand ils volent entre les gratte-ciel. Nous détruisons des habitats, nous en créons de nouveaux. Maintenant que la science a montré que rien n’est vierge et que la nature s’adapte, il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour les objectifs environnementaux traditionnels comme la protection des forêts tropicales. Kareiva et ses collègues se demandent si l’arrêt de la déforestation de l’Amazonie est faisable. Est-ce même nécessaire ?
Au-delà du domaine de la conservation, les néo-environnementalistes se distinguent par leur attitude envers les nouvelles technologies qu’ils voient de façon positive. La civilisation, la nature et l’homme peuvent être sauvés seulement si nous appréhendons de façon enthousiaste les biotechnologies, la biologie de synthèse, le nucléaire, la géo-ingénierie et n’importe quoi d’autres avec le préfixe néo qui « ennuie Greenpeace ». La focalisation classique des verts sur la question des limites est rejetée comme étant naïve. Nous sommes devenus des « Dieux » et nous devons accepter et intensifier notre gestion rationnelle de la planète grâce à l’usage des nouvelles technologies guidés par la science éclairée.
Les néo-environnementalistes montrent également un grand enthousiasme pour les marchés. Ils aiment donner un prix à des arbres, des lacs, des animaux, des forêts tropicales et des bassins versants, tout ce qui apporte des services écosystémiques pouvant être acheté ou vendu, mesuré et additionné. Ajouter à cela une attitude quasi religieuse envers la technoscience. Tout ce qui compte vraiment peut être mesuré par la science et évalué par les marchés et toute objection sans validation scientifique ou sans valeur reconnue par les marchés peut être facilement rejetée. Cette position est présentée comme étant du pragmatisme, mais en réalité il s’agit d’une tentative d’exclure du débat sur l’écologie tout argument fondé sur la morale, l’émotion, l’intuition, la spiritualité ou simplement un sentiment humain.
Ces néo-environnementalistes n’apportent finalement rien de nouveau dans le débat. Ils recyclent les bons vieux paradigmes des scientistes qui ont une foi aveugle dans la technoscience et pensent que la menace actuelle d’effondrement de la biosphère et de l’humanité sera réglée par des progrès technologiques. Ils sont selon Arne Naess, théoricien de l’écologie profonde, des écologistes superficiels. Ils s’attaquent aux problèmes en en créant d’autres, sans aborder les racines de la crise profonde de notre civilisation fondée sur la croissance et l’hyperconsommation. Le philosophe norvégien pense au contraire qu’on ne pourra vivre durablement sur cette planète qu’en remettant profondément en cause notre rapport de domination sur la nature, ce qui nécessite un changement radical de notre rapport à la nature. Ces néo-environnementalistes raniment le vieux débat entre ceux qui ne voient la nature que comme une ressource à notre service et ceux qui reconnaissent à la nature une valeur intrinsèque nécessitant de laisser des terres en libre évolution pour la survie des organismes vivants non humains.
Ils passent sous silence que nous sommes en pleine crise d’extinction de la biodiversité comme l’ont établi récemment les experts de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais). Ils partent d’une évidence – la nature possède des capacités de résilience – pour en faire une vérité absolue. La nature est résiliente, c’est-à-dire qu’elle est capable de revenir à son état initial après une perturbation, si et seulement si, elle est riche et diversifiée et peu modifiée par l’homme. Or des chercheurs ont mis en évidence de nombreux cas de coupes dans des forêts tropicales qui, après le déboisement, repoussent, mais avec des espèces exotiques qui ont remplacé les espèces autochtones, voire endémiques dans le cas des îles. Ces scientifiques considèrent que ces « nouveaux écosystèmes » ne peuvent plus être restaurés pour revenir à leur état antérieur à la révolution industrielle car trop de paramètres ont modifié profondément les sols et les végétaux dans leur ensemble (augmentation de la température, accroissement du gaz carbonique, polluants, changement d’usage des sols, introduction d’espèces exotiques). Dès lors, la résilience de nombreux écosystèmes est clairement remise en cause (2). Une forêt naturelle se régénère seule après une tempête avec les espèces d’arbres présents, alors qu’une forêt fréquemment incendiée par l’homme ne voit repousser que les arbres favorisés par le feu tandis que les autres régressent.
La résilience possède divers degrés et c’est aller vite en besogne que d’affirmer que l’homme peut tout se permettre puisque la nature revient. Le parfait exemple est la zone d’exclusion de Tchernobyl où effectivement la forêt repousse, les villages disparaissent sous la végétation et des animaux sauvages réapparaissent (loups, élans, aigles, tétras lyres, cygnes chanteurs, etc.) dans les zones abandonnées par l’homme, preuve s’il en fallait une, que l’homme ne laisse pas beaucoup de place aux non humains. Mais la contamination radioactive est partout, dans les sols, les eaux, les végétaux, les animaux et les hommes. Est-ce cela que les néo-environnementalistes appellent la résilience ?
Volontairement, ils confondent nature vierge et nature sauvage pour argumenter le fait que l’homme a tout modifié et influencé et que se soucier de la nature n’a plus grand sens. Mais c’est refuser de voir la nature sauvage réelle qui s’installe partout où l’homme cède la place : une friche agricole, des herbes folles sur un trottoir, le loup qui se joue des frontières, des forêts qui succèdent à des pâturages ou des plantations abandonnées. Les exemples ne manquent pas de cette nature férale qui pourrait nous apporter de nombreux enseignements face aux changements globaux.
Mais ne nous trompons pas, la nature en ville évoquée par les néo-environnementalistes ne remplacera jamais celle d’un écosystème naturel diversifié, fonctionnel et mature. Toutes les espèces ne peuvent pas s’adapter à la ville. Seules les espèces anthropophiles qui se nourrissent de nos déchets ou d’autres espèces liées à l’homme (pigeons, corvidés, rats et souris) peuvent vivre dans les mégalopoles, anxiogènes pour les hommes et inhospitalières pour la nature. Seules les villes qui possèdent des forêts périurbaines peuvent se targuer de vivre à proximité de la nature. Pour le reste il ne s’agit que de certaines espèces (toujours les mêmes, renards, coyotes, faucons crécerelle et pèlerin) qui s’adaptent à cet environnement très artificiel où leur seul avantage est de ne pas y être persécutées.
Les néo-environnementalistes rejettent l’idée de donner des limites aux actions de l’homme. De ce fait, la domestication totale de la nature est un danger pour la nature et pour l’humanité, notamment au travers d’une vision naïve de la technoscience et de tout ce qu’elle peut engendrer pour faire de l’homme et de la nature un objet. Le risque d’une domestication globale de la nature sauvage est double : supprimer les milieux de vie des espèces non humaines et en finir avec l’héritage ontologique de l’homme qui a vécu plus longtemps pendant la période paléolithique que celle du néolithique, c’est-à-dire changer profondément la nature et l’homme.
Avec de tels environnementalistes, les défenseurs de la nature sauvage n’ont pas besoin d’ennemis. Il n’y a plus qu’à attendre, ils ne vont pas tarder à se faire entendre aussi chez nous.
(1) Kingsnorth P. In Wuerthner G., Crist E. and Butler T. 2014. Rise of Neo-greens. Keeping the wild. Against the domestication of earth. Island Press. Pp. 3-9.
(2) Hobbs R.J., Higgs E.S. and Hall C.M. 2013. Novel Ecosystems. Intervening in the New Ecological World Order. Wiley-Blackwell. 368 p.




